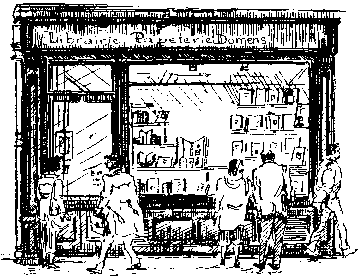
Mai 2006... Mai 2006... Mai 2006... Mai 2006... Frédéric Jacques Temple, dernier aborigène blanc A propos du Chant des limules, Actes Sud, 2003
C’est sur le dos d’une limule que Frédéric Jacques Temple nous emporte au fond des océans, de sa mémoire, de son âme d’humain. S’étant rendu à Long Island, sur l’invitation du directeur de l’Amagansett National Wildlife Refuge, pour observer les Balbuzards, il se retrouve sur le territoire des Algonquins. Il aperçoit, lors d’une marche méditative sur Peconic Bay, une de ces Limulus polyphemus, échouée sur le sable. En s’identifiant à ce « fossile vivant », Temple crée, par ce récit, un pont entre ses lectures et la Nature aujourd’hui. Sa quête du Balbuzard, oiseau rare, en voie d’extinction, est un rappel à ce que nous savons tous, mais que nous refusons de d’admettre : peu à peu les choses et les êtres disparaissent, et ce, définitivement. Alors que certains se contentent de vestiges, de musées, Temple explore, cherche, se consacre tout entier dans cette aventure qu’est la quête de la Vie, sous toutes ses formes. Tour à tour scientifique, poète, acteur, témoin, ce conteur d’exception fait surgir son univers pour notre plaisir. « J’ai toujours eu le sentiment chaque fois de moins en moins confus d’être le contemporain d’époques révolues », nous dit-il. Cependant, cède-t-il à la nostalgie ? Pas vraiment. Il improvise sur ses propres souvenirs, comme Cendrars a pu le faire dans Bourlinguer. Temple marche également sur les pas de Whitman, le premier poète non pas Américain, mais des USA tous entiers. Les anecdotes sur la vie du poète se superposent constamment à la narration, si bien que le temps et l’espace se mélangent, forment un tout incoercible : rêve et réalité, nuit et jour se confondent, dans un crépuscule, une aube infinis.
Enfant, adolescent, ses lectures vagabondes qui l’entraînaient, semble-t-il, dans le Nouveau Monde, dotaient l’Ancien de potentialités incroyables. Et alors que Temple se trouve aux Etats-Unis des années plus tard, terre d’asile de son imaginaire, le récit tend à raviver cet espace, quelque part dans le Sud de la France, où tout a débuté.
Le chant des limules, qui existe bel et bien désormais, a, je crois, la résonance du premier mouvement de la Sonate au Clair de Lune, de Beethoven.
Ce récit, composé par et pour Mémoire, « qui protège de la seconde mort, la plus terrible selon T. Hardy, l’oubli » est une évocation, quelque chose comme l’écho que les montagnes ancestrales nous renvoient poliment, pour mieux nous rappeler que nous ne sommes pas éternels.
Que Frédéric Jacques Temple ne cesse donc jamais de se « fossiliser » sous la forme livresque, il y aura toujours des collectionneurs pour ses raretés !
Jean-Louis Benavent
Au grand Large
A bouts de bras il a déposé
éperdus sur les épaules du vent
des mots sortis des reins de la terre.
Mots qui ont leurs racines dans ses mains
ruisselants par chaque bout, à bout portant
éreintés quittant l’érosion des tombes
épousant la lumière pêle-mêle qui effare les yeux.
Sève solaire
le souffle de sa poitrine disperse le pollen.
Cela se boit.
Dans l’étreinte du vent.
Comme un alcool fort. Cul sec. A la pointe du jour.
Murmure et mûrit un soleil démesuré qui se lève en fanfare
Fruit flamboyant d’une parole entière, d’un jeu mûri et toujours vierge.
Rien ne tremble
Sinon la lumière brillant sur les éclats à terre du verre lancé, brisé, par dessus l’épaule.
Dans l’ivresse des confins toujours la voile d’un nuage d’or épouse le vide.
Santé à vous, Frédéric Jacques Temple ! Buvons ensemble les embruns du large ! Jean-Marie de Crozals Février 2006... Février 2006... Février 2006...
Samarkand ! Samarkand ! Monsieur Toussaint Louverture, numéro quatre
Ce cri de vigie, au sortir des brumes annuelles post-festives, est un appel au merveilleux. Samarkand, pour la petite histoire, fut une capitale de l’empire ottoman. Elle se trouve aujourd’hui en Ouzbékistan. Fondée au XIVe siècle par Timur Lang (Tamerlan, en V.F.), qui n’était pas la moitié d’un mégalomane puisqu’il se prétendait l’héritier de Gengis Khan, Samarkand fut un centre intellectuel et artistique au rayonnement cosmique (j’exagère à peine).
Ce nouvel opus de l’équipe de Monsieur Toussaint Louverture mérite le qualificatif de « super », si cher à ses concepteurs. Pourquoi est-il “super” et pas juste “bien” ? C’est parce que cette revue, débordant d’enthousiasme, est réalisée avec de petits moyens et qu’en voyant le résultat du travail de ces jeunes gens, on ne peut qu’être absolument ébloui (par très beau temps, de préférence). Une qualité de papier largement satisfaisante, une couverture joviale et décalée, des illustrations aberrantes de créativité. Un petit livre qui mériterait sa place dans la bibliothèque de des Esseintes, le dandy d’A rebours, de J.K. Huysmans.
Mais surtout, et c’est essentiel, douze histoires remarquables. Douze contes de styles très différents (de la pureté Hemingwayienne à la complexité de Kafka) ayant pour thématique enfouie un lieu magique, utopique, une atmosphère confinant à la rêverie. Dans la diversité de ces textes, il y a toujours un espace qui canalise nos émotions vers le fantastique.
Que ce soit en pays de Caux, avec Aube, de Matthias Gosselin, ou au Mexique (le diable ne se paye pas en Tequila, de Didier Rouge-Héron), on a l’impression de flotter entre les lignes, hors du temps ! Tout les univers oniriques de ces auteurs s’offrent à vous pour une poignée de dollars (nous acceptons aussi les euros).
Le numéro quatre de Monsieur Toussaint Louverture est un instant de détente, il faut s’y jeter à corps perdu, comme l’indique la gravure du très joli marque-page d’Anne Careil qui accompagne ce livre. Et, une fois arrivé à Samarkand, espace de liberté artistique, laisser libre cours à la poésie, à l’innocence et au rire.
PS : L’abus de parenthèses étant dangereux pour la santé, je vous recommande de lire ce texte en les évitant soigneusement.
Jean-Louis Benavent 1er Novembre 2005...1er Novembre 2005...1er Novembre 2005...
L’inventaire du bonheur Alphabet pour Joseph Delteil, Jean-Louis Malves, éditions Domens Avec la plus âpre et jouissive conviction nous est livré, dans cette odyssée jubilatoire, rabelaisienne et polymorphe de Jean-Louis Malves, le lieu de l’utopie, le lieu de tous les lieux, de tous les liens, la clef essentielle qui ouvre en grand toutes les portes. Il ne suffira pas de les ouvrir mais de passer le seuil et d’entrer dans la chair ébouriffante du monde, ce lieu d’utopie, ce Graâl qui n’est autre que nous même en chair et en os.
Oui, prendre la clef des champs et parcourir le chemin de notre nature humaine, aussi vaste que le cosmos. Redécouvrir en nous l’homme “ nu, pur, libre, cueillant chaque aurore nouvelle” ; redéployer tous nos sens et faire corps avec l’univers.
Une de ces portes s’ouvre sur un jardin nommé Choléra, un paradis retrouvé sur terre, “deux jambes avec un nez dessus et un sexe entre”, éclair fugitif et pugnace de la beauté incarnée dans la chair du quotidien ombiliquée à la plus haute aspiration-inspiration, celle de vivre pleinement la réalité, celle-là même que nous respirons tous les jours.
“ Nous avons 100 000 ans et sommes nés ce matin” : vivre c’est s’accoupler à la vie, aimer sans mesure ni modération.
Il n’y a pas d’autre chemin.
“ Un secret de vie que nous lègue Joseph.”
Jean-Marie de Crozals
1er Octobre 2005...1er Octobre 2005...1er Octobre 2005... Antoine Blondin, à travers des vapeurs éthyliques « L’homme descend du songe » A. Blondin Dans le cadre de la projection du film : Un singe en hiver , d’Henri Verneuil (réalisateur), en hommage à Michel Audiard (scénario & dialogues), il est du devoir du libraire assidu de rendre un autre hommage, à Antoine Blondin (l’auteur) cette fois.
Le livre, un singe en hiver, est paru en 1959 à la Table Ronde, une année qui a fait connaître au grand public la nouvelle vague (avec A bout de souffle, les 400 cents coups) ainsi que Jean Paul Belmondo. Pour ce texte, Antoine Blondin reçut une assez haute distinction : le Prix Interallié. Chose étonnante pour un romancier défenseur de Robert Brasillach et Lucien Rebatet qui mériteraient, eux, le Prix ‘‘Intercollabo’’ s’ils avaient fait long feu (follet !). En effet, l’un a été fusillé à la Libération et l’autre fut condamné à mort (puis gracié).
Ayant quitté les S.T.O., Antoine Blondin a commencé sa carrière d’écrivain avec l’Europe Buissonnière (Table Ronde, 1949, Prix des Deux Magots). Engagé par L’Equipe, il couvrira le Tour de France durant plusieurs décennies, ainsi qu’un nombre considérable de bistrots. Certes, Antoine Blondin levait le coude abondamment. A ce propos, une anecdote relatée dans L’Humanité, après sa mort, en 1991 : « Une jour, à l’Equipe, ayant reçu une note de frais un peu salée composée uniquement de devantures de bars, le directeur financier, lassé, pria l’écrivain de se justifier. Ce qu’il ne manqua pas de faire par ces mots : ‘‘Verres de contact’’. » Si l’histoire n’est pas à priori vérifiable, elle reflète néanmoins assez bien le personnage.
On a souvent confondu, à tort peut-être, certains romanciers avec leurs héros, notamment pour l’époque Roger Nimier avec François Sanders le Hussard Bleu, et Antoine Blondin avec Gabriel Fouquet, le protagoniste d’Un singe en hiver.
Si la question « Qui était réellement Antoine Blondin ? » n’a pas de sens, on peut se pencher sur son double littéraire. Le jeune Fouquet est un passionné d’Histoire, de boisson, et souhaite fuir sa réputation autant que ses amours blessés. Il est de cette jeunesse qui porte le fardeau des grands hommes d’autrefois, ce que Plutarque a nommé « le syndrome d’Alexandre ». Se sachant pertinemment voué à la solitude, il cherche le salut, la communion dans l’alcool : « Au second verre, nous explique Fouquet, j’ai senti renaître le vieux désir de connaissance avec les autres, ce sentiment d’avoir beaucoup de choses à leur communiquer, et l’illusion qu’on pourrait s’arranger pour vivre si l’on était assuré d’une marge où l’existence s’échauffe et brille dans ses plus modestes manifestations. » Autrement dit, la sublimation du quotidien par le rêve éveillé. « Enivrez-vous ! » s’écriait Baudelaire.
La quête de Fouquet, car s’il fuyait sans raison, on découvre peu à peu qu’il se rend quelque part, est celle de l’amitié. Il s’imagine une amitié virile à la Hemingway, une amitié où il serait possible de dire : «partageons le manteau; il est trop lourd pour moi. J’ai vu la mer : on ne peut pas aller plus loin…» Ce sentiment d’impuissance et de doux désespoir, pour Blondin, pourrait être guéri par la fraternité.
Derrière la scène, dans les cœurs des personnages du Blondin d’Un singe en hiver, se joue la comédie de la nostalgie : de la jeunesse et de l’action pour le vieux Quentin, l’hôte du héros ; de l’amour et des retrouvailles impossibles pour le jeune Fouquet.
Sans révéler le dénouement, pour les futurs lecteurs, il n’y a de réelle communion que dans l’amour filial, pour peu qu’on lui en laisse la place en ouvrant son cœur.
Le style fin et amusé d’Antoine Blondin, pour finir, est comme l’olive que l’on plonge dans le Martini : réfutable, et pourtant nécessaire à l’ensemble. Jean-Louis Benavent Vendredi 19 juillet 2005...Vendredi 19 juillet 2005...Vendredi 19 juillet 2005...
Patrick Singh :
autoportraits en forme de lame de fond L’œuvre de Patrick Singh nous fait voyager dans les méandres refoulés de notre histoire humaine car en ses portraits, celui ou celle qui nous regarde c’est bien l’autre en nous, que nous refoulons et dont nous ne reconnaissons pas la différence, et pire : nous accusons cette différence. Nous l’accusons, nous sentant coupables et nous la révélons à notre insu en accentuant les traits de sa propre mise en scène par les expressions de notre culpabilité.
Patrick Singh nous montre et nous fait ressentir cette culpabilité et mauvaise conscience et aussi sans doute la sienne propre. De par le jaillissement du fond de l’âme, d’une lame de fond de lave brûlante d’humanité.
Dans la verticalité frontale des portraits, le mutisme de la posture, de la bouche et du regard, la posture hiératique est soulignée par la contre-plongée du point de vue : le regard à ce moment pénètre l’âme tel une lame.
L’âme douloureuse d’un pays éclaire le visage des stigmates d’une culture colonisée par notre société dévorante de contre-cultures. Réflexion désabusée qui ne laisse pas abuser et dénonce les abus de pouvoir de notre regard sur les choses et les êtres.
Montrer c’est prendre parti.
Les visages nous dévisagent, scrutent en nous l’obscur mouvement de la pensée, révèlent cette part maudite que nous avons à réintégrer pour ne pas disparaître engloutis sous le lavage de cerveaux de nos neurones fragilisés.
Se terre dans nos regards, s’acharne une impuissance fiévreuse, une constante retenue d’âme. Qui donc pourra faire craquer le barrage derrière lequel s’amasse tant de mansuétude et libérer le lac des yeux enfin débordant de toutes les larmes de l’homme ? Regards qui par dessus l’épaule du monde, notre épaule, scrutent yeux plissés, nous surplombant par la réflexion qu’ils suscitent en nous qui les regardons de notre position assise : assis sur le monde nous le contemplons bouger et vaciller. Et par delà le monde du regard, en son antre, nous parvient la flamme obscure de son intimité, l’étincelle de vie qui nous foudroie alors que sa source de feu est peut-être éteinte depuis bien longtemps. Magie et puissance de l’œuvre de Patrick Singh qui nous transmet la force de réflexion, de pouvoir réagir et agir sur notre condition humaine.
L’œuvre fait vibrer en nous cette corde, l’arc est bandé, la flèche de l’action prête à partir.
Je vois Patrick Singh e,n tous ses portraits, en tous ces regards aveuglés et aveuglants, je vois l’aile sombre et lumineuse de son regard traversant le champ de réflexion de son art du voyage. J’y entrevois en un mimétisme foudroyant, la trace humaine, le fond commun de dignité et de résistance à la barbarie qu’il porte et qu’il projette, en miroir par l’entretien qu’il a avec le monde. Du fond de l’âme une lame de fond remonte jusqu’à nos yeux, au bord des paupières…
Vibrante corde qui résonne en chaque feuille de ses carnets, le cœur de Patrick Singh bat la chamade au rythme de ce qu’il traverse et le traverse. Il est là partout où il doit être dans l’humain profond de sa conscience d’éveillé. Il nous réveille et il suffit de prendre le temps de regarder en face et de passer de l’autre côté du miroir, du fond et de derrière le regard de ce qui nous regarde, voir cette lumière noire qui nous rend à l’ivresse de vivre notre liberté d’homme : l’homme de Patrick Singh nous révèle et nous délivre de notre propre aveuglement.
Jean-Marie de Crozals
Livres de Patrick Singh :
Handle with care, monographie, Domens, 2004
Des lieux sans importance, textes de Daniel Bégard, Domens,2002
Palenque de San Basilio, avec Patric Clanet, Julien Molino, préface d’Yves Monino, Domens, 1999
15 Juillet 2005...15 Juillet 2005...15 Juillet 2005...15 Juillet 2005
Kyoto Béziers
A Kyoto
Pierre Duba
Editions 6 pieds sous terre
Ombres japonaises« Dans la brume de l’aube tournoie le son d’une cloche »
Cette phrase retentit et résonne comme un poème japonais dédié à la montagne et à ses vallées. De la brume, forcément il y en a beaucoup, partout présente dans l’univers aquarellé de Pierre Duba. Une vapeur glacée bleu-vert envahit le paysage, les villes, les visages…Apparaissent et disparaissent des images figitives, troublées et troublantes, comme revenues du fonds du temps et de l’espace.
Dans la montagne
Emmuré vivant
Le souffle agite la cloche de l’esprit
Une femme s’évanouit
Dans la neige de son corps
Petits pieds à petits pas
Femme emmurée ne mûrit plus
Son corps est le fondement du silence
Sa bouche tète le lait de la mort
Son sein nourrit le chant qui nourrit la nuit
Ses seins la voie lactée
Chantent le silence fertile
Musiques Poussières
Danses Transparences
Encens Béances de rêves
Contemplation
Kakis couleur rouille
Aux vents d’automne
Se balancent
Buée vole Dragon vole
Joug des images
Bulles de Chimères
Partout buée
buée
buée
Et pourtant le son lointain d’une cloche dans la vallée !
Jean-Marie De Crozals 
Appréciations sur l’œuvre de Pierre Duba
« Words, words, words » Hamlet Je supposais, lorsque je me suis mis en tête d’écrire un article sur l’œuvre de Pierre Duba, qu’il me serait aisé de dire tout le bien que je pensais de l’artiste et de son univers.
Plusieurs mots étaient venus, seuls, de leur plein gré si j’ose dire, se juxtaposer, s’agglutiner au Kyoto Béziers ou A Kyôto : incohérence disciplinaire, magie, folie, détails, ensemble, exagération, minimalisme, brouillon essai, quête, recherche, temps, absence de temps, fuite voyage, angoisses, retour…Mais aucun d’entre eux ne voulait se détacher du noyau, de la pelote qui s’était formée. Quel mot servirait de clé au déroulement de l’article ? Impossible à définir. Électrons anarchiquement disposés en orbite autour de l’œuvre. Cet agglomérat me paraissait confus et qui plus est incoercible. Et puis soudain, le hasard ?
Non, il n’y eut pas de hasard : simplement un étrange classement remontant à la surface, à la conscience. Les noyaux « Vie » et «Mort » parurent à travers le chaos. Et le noyau « Duba & œuvres » fut promu au rang de cellule. Les mots, jusqu’alors désordonnés, se mirent à danser d’une manière quelque peu effrayante. Pourtant, je distinguais des trajectoires stables, des traits identifiables. Le voyage des mots se répétait indéfiniment, « vie » et « mort » se partageant lettres, syllabes, mots recomposés.
Agissant scientifiquement, tentant de prendre mesure de ce phénomène, j’appliquai une vitre sur cette cellule vivante et m’éloignai de quelques pas. J’aurais tout aussi bien pu l’observer au microscope puisqu’il n’y a, somme toute, aucune différence entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.
Et c’était là : le ballet anarchique des mots, vu de loin, n’était que traits appliqués entre la vie et la mort, ébauche d’un paysage de solitude, un paysage d’enfance ou pays de Cocagne. Immobile et remuant puisque partie de la mort comme de la vie.
Ce dessin de mots ressemblait à s’y méprendre à une esquisse de Pierre Duba. Et alors même que ces mots m’étaient invisibles, il me sembla qu’ils prenaient un sens réel.
L’espace d’un instant, je vis ce paysage parlant, et entendis la musique des mots. Je replongeai dans la tourmente pour en saisir l’origine. Alors même que j’y plongeai, tout se déroba. Rideau !
De nouveau le vide. Pas de critique donc. Seulement une invitation au voyage, à accomplir individuellement.
Jean Louis Benavent
17 Juin 2005...17 Juin 2005...17 Juin 2005...17 Juin 2005
Les Mille et une nuits
Tome premier
Bibliothèque de la Pléiade 2OO5
Nouvelle traduction
d’André Miquel et Jamel Eddine Bencheikh
« 1000 nuits + 1 ou la nuit blanche du récit »Les 1001 nuits, chef d’œuvre inégalé de la littérature arabe, tout le monde connaît. Connaissance souvent folklorique, exotique, voire érotique… De la version « soft » pour jeunes lecteurs de la littérature enfantine de conte à la version « hard » genre kamasutra à la sauce occident…, nous sommes ici en présence, grâce à cette nouvelle traduction émérite, d’une littérature fantastique et merveilleuse d’une qualité incroyablement séduisante et ludique. A vous, lecteur, d’essayer, passant par dessus les préjugés, les clichés, les affadissements de toutes sortes qui ont été véhiculés par la rumeur. Laissez-vous emporter par la magie ébouriffante du récit de Chéérazade à son roi…
Voici la trame de départ :
“Un roi, trompé par son épouse, décide de tuer chaque matin la compagne toujours renouvelée de sa nuit. Une jeune fille tente pour sauver sa vie et celle des autres femmes du gynécée de tenir en haleine la curiosité du roi par les merveilles de son récit.”
...
« Mais l’aube venait reprendre Chéérazade, parler n’était plus permis : elle se tut. »
Leitmotiv qui revient résonner comme un glas et qui engendre en même temps la possibilité de la remise en jeu de la parole.
Où le silence est d’or. Dort en lui le meurtre en puissance – sa puissance – et aussi le pouvoir de l’amour. La langue du conte se met au service de l’amour charnel où tous les mots s’abreuvent au silence.
« Elle se tut » donc, à défaut d’être tuée : la parole, tue, se mue –silencieusement muette- en monnaie d’or, meurtre mué en silence d’or, le prix du silence.
C’est la fin du récit. Du moins en apparence car si son fil est coupé, l’aube sera couleur de sang d’une femme…
S’évanouit dans l’inter-dit l’aveu de toute langue, où mourir serait peut-être cette parole à l’orée de l’inaccessible, aux confins du langage. Se déposerait en ce lieu de non-dit la vérité de tout récit.
Dire ou ne pas dire, corps soudain livré à la solitude muette de son essence, en son silence de mort.
Chéérazade parle pour raconter, dis-traire (du meurtre), mais ce détour de la langue renoue en fait avec l’origyne, la redite origynaire de toute parole, où à chaque nuit elle puise à la source intarissable de la langue . Il n’y a d’autre que la langue du conte pour le dire, c’est à dire le redire.
Le dernier mot, elle l’aura. Ce en quoi il y aura rature de son origyne. Où parle un silence de mort. Le silence, l’entre-tien est bien ici le sceau ou le blason de langue sur lequel se fonde le récit (sans fond).
Sous le voile du récit, la parole féminine scellée, celée ou gelée (provisoirement) séduit le sens de l’histoire.
Elle montre sans se dévoiler l’in-visible, l’inouï de tout récit. Où le silence ou plutôt l’arrêt de mort du mot
revient sonner, résonner en chacun d’eux, hanter le corps, sa langue prête à être ré-animée chaque nuit, chaque fois qu’un nouveau souffle lui est rendu…Merveilleux ici le stratagème du fil de la parole qui tisse et tire l’écheveau et la trame kaléidoscopique du récit , qui nous tient en haleine suspendus au souffle de la nuit devant cette tapisserie imaginaire et colorée de tous les mots du monde qui se construit sous nos yeux…
Dans la syncope, la césure, la langue touche et s’anime au lieu indécidable, entre crépuscule et aube où la vérité du récit – son fond – ne résonne que depuis ce silence. D’un moment à l’autre tout peut s’éteindre, où peut-être une étincelle jaillira ?
En faisant différer sans cesse la fin (et la mort), la parole creuse le présent, le dilate, le relate, le met en relation, perpétuant la vie sous la forme du conte et de ses merveilles (le récit dans le récit).
Le Roi – l’Aube – coupe la parole à Chéérazade – la Nuit -, et donne pour ainsi dire le coup d’envoi(x) de la parole in-interrompue : puissance magique qui ne recule devant rien. Du coup elle se libère du poids de la mort pour devenir vivante création du monde.
Une voix nous appelle, la parole de la nuit, ivresse sacrée, source jaillissante qui enivre les oreilles et radoucit les mœurs – les morts ? -
Ce que cette voix invente et trouve (troubadour ?) – par la reprise quasi obsessionnelle du « on raconte encore… », c’est l’aube de la langue par la bouche de Chéérazade où viennent éclore des mots comme des fleurs. Comme pour la première fois, elle nomme à chaque fois l’écart in-fini du jeu de la parole : merveille que cette infinitude de parler pour parler, en fin de compte (toujours l’exorbitante unité en plus), soit sa res-source, son ressort et sa vérité : coup d’envoi et remise en jeu : la fin n’aura pas son compte car toujours en plus il y a un…
La parole est congédiée sous la forme initiatique de l’aube, d’une césure dans le temps. Eveil à la vérité dans le dénuement du silence et de l’amour. Où l’aurore coupe la langue à la parole de la nuit, là, il n’arrive effectivement rien : le sang ne coule pas, les mots sont gelés, frémit juste le suspens de deux corps suspendus aux lèvres délicieusement silencieuses de l’amour… Le séjour de la parole tue est la force magique qui reconduit sans cesse l’histoire et qui sera le ressort – l’heureux sort - du destin de Chéérazade.
Plus rien à entendre sinon le souffle coupé du suspens amoureux. La parole s’éteint – elle ne décline pas, elle est littéralement soufflée par la venue du jour – au moment où va s’allumer l’aurore : et « l’aube venait reprendre Chéérazade » : transport vide, transfert magique.
Victoire du mot sur la mort, et aussi triomphe de l’amour : 1OOO + 1 ou l’impair qui parfait tout bouquet…
La plus haute féerie est bien celle de reconduire la mort et le récit, de retarder l’échéance, le dénouement, toujours « à suivre » : il était une fois et encore une fois, car on ne connaît pas de nuit qui ne mène à l’aurore…Et la mort repassera…
André Miquel nous livre ici dans la prestigieuse collection de la Pléiade une traduction à la fois poétique et rigoureuse qui ravit nos sens et notre intellect. Elégante et harmonieuse, fidèle à l’esprit et aux mouvements subtils et sensuels de la langue merveilleuse du conte. Messieurs Jamel Eddine Bencheikh et André Miquel nous transmettent en résonance la puissante et somptueuse magie des saveurs et des souffles de l’imaginaire arabe et oriental.
Laissons-nous donc envahir par la magie du conte, traversons encore une fois le fleuve de la langue jusqu’à nous perdre dans l’instant magique, vérité inouïe et jouissante qui tient tout entière dans les mots précaires, éternels, pure merveille des sens. Et ainsi enfante le Monde. La lumière de l’aube nourrit les mots et annonce la fin. Elle l’annonce mais ne l’énonce pas ni ne la nomme. Jamais. Il était une fois, à chaque fois, l’éclair de l’attente, l’attente de l’éclair et la hâte jubilatoire de ne pas en finir.
Jean-Marie de Crozals
10 mai 2005... 10 mai 2005... 10 mai 2005... 10 mai 2005... Plan 9 from outer space sur 6 pieds sous terre, édition BD à Frontignan
Comment je suis devenu stupide
Nikola Witko
Martin Page
Suivi de
Introduction à l’ontologie de Jean Claude Van Damme :
le concept aware, la pensée en mouvement
M. Vandermeulen
C’est l’histoire d’un type qui pense trop, tourmenté qu’il est par son incapacité à appréhender le monde autrement qu’intellectuellement. Un monde, où, d’après lui, la réflexion est une tare, où la connaissance est une fin en soi, la culture un simple faire-valoir.
L’intelligence, disait Desproges, est le seul outil qui permet à l’homme de mesurer l’étendue de son malheur.
Alors, pour ne pas passer à côté de ce que d’aucuns appellent la « vie », et après un séjour en hôpital, il décide d’expérimenter une lobotomie chimique en se gavant de pilules anxiolytiques. Il perd son sens critique, sa morale, son éthique.
Dès lors tout lui sourit : engagé par un ancien camarade d’études comme courtier en bourse, il surfe rapidement sur des succès maladroits qui lui assurent la reconnaissance sociale. Pack d’amis, pack d’amantes, pack d’amusements, de choses (Perec en 63 !). Tout se gâte lorsqu’il oublie de prendre son Soma, cette drogue que décrit Aldous Huxley dans le meilleur des mondes. Est-ce alors une descente aux enfers ? Les affres de l’entendement reprennent leurs droits…
Cette BD, racontée avec une humilité certaine, ainsi qu’une sobriété dans le dessin a juste ce qu’il faut d’humour (noir bien sûr), pour se faire le chantre subtil de l’intelligence.
La plupart des BDs de 6 pieds sous terre traitent d’un malaise général. Nous ne pouvons nous empêcher de penser à ce propos aux chroniques éponymes de François Nourrissier (comprenant : bleu comme la nuit ; un petit bourgeois ; une histoire française).
Il s’agit donc d’un travail de fond qu’effectue cette maison d’édition, dont le nom est alors justifié pleinement ! Toute la difficulté de la vie, et c’est ce qui fait son intérêt, c’est d’entrer dans une société de plus en plus hostiles aux pensées, d’où la pensée unique, qui met l’effort intellectuel entre parenthèses.
Deux cas de conscience possibles pour aborder l’existence :
D’une part, refuser de compromettre son éthique et adopter une (im-)posture cynique.
D’autre part, tuer notre humanisme contestataire et glisser vers la mort de l’âme.
La première attitude, parasitaire, nous fait condamner une société sans laquelle pourtant nous n’existerions pas.
La seconde est une sorte d’hédonisme du profit.
Bien sûr, dégager deux solutions ultimes peut paraître manichéen (comment je suis devenu stupide l’est quelque peu, avouons-le) surtout lorsqu’on sait que sous l’occupation allemande durant la seconde guerre mondiale, il y avait d’un côté la résistance, de l’autre la collaboration et au milieu les trois quart de la population Française mortifiée.
Malgré tout, rappelons cette phrase de Blondin ( Clint Eastwood) dans le bon, la brute et le truand, de Sergio Leone : « dans la vie, il y a deux catégories : ceux qui ont des flingues chargés, et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. »
Hors de la noirceur de certains ouvrages de la maison d’édition de Frontignan, dont nous ne faisons qu’effleurer les contours, fossoyeurs/critiques que nous sommes, il y a place pour le rire franc (enfin, belge) : le texte de M Vandermeulen, initiation à l’ontologie de Jean Claude Van Damme, le concept aware, la pensée en mouvement. La lecture de cet essai a non seulement l’avantage de vous ôter tout marasme en faisant travailler sévèrement vos zygomatiques, mais en plus vous avez l’occasion de réviser quelques concepts philosophiques ! Sous le couvert d’une étude comportementale (qui vire au règlement de compte entre spécialistes farfelus), Vandermeulen présente l’acteur Hollywoodien comme le Socrate des temps modernes et tisse autour de lui nombre de délirantes hypothèses pour expliquer quelques uns des dogmes awaristes de Van Damme. « Je crois en Seigneur…Un plus un égale un. » On apprend également qu’un biscuit n’est rien, mais que le biscuit est composé d’œuf et que dans l’œuf, il y a la potential life, concept expliqué dans l’ouvrage. L’état de perplexité dans lequel nous sommes plongés face à ces aphorismes et à leur exégèse laisse rapidement place à un fou rire incontrôlable. Le texte est accompagné d’illustrations fort à propos, rappelant que tout ceci, n’est, finalement, qu’une sérieuse farce.
L’intelligence, c’est comme le parachute, quand on n’en a pas on s’écrase. Jean-Louis Benavent 30 avril 2005... 30 avril 2005... 30 avril 2005... 30 avril 2005... Amours d’occasion d’Enrique Serna, éditions Atelier du Gué, 2004 A l’heure où des hommes et des femmes sont apparemment plongés dans une béatitude qui confine à la pathologie, happés qu’ils sont par l’image qu’on leur renvoie d’eux mêmes, il est bon de voir le mécanisme des passions telles que ces hommes et ces femmes les pratiquent, démonté et expliqué avec les mots justes et teintés d’ironie d’Enrique Serna dans Amours d’occasion.
À travers onze nouvelles, Enrique Serna nous plonge dans un univers dépourvu d’espoir, mais pas de tendresse ; un univers insolite à la fois singulier et universel, tant les sentiments qui y sont disséqués font partie intégrante de la vie quotidienne moderne.
Basées quelques fois sur un postulat irréel plus proche du conte que de la nouvelle – et en cela Serna est effectivement un descendant de Borges, Cortazar ou Marquez - les histoires racontées par des personnages surprenants d’authenticité nous laissent songeurs : non pas dans un monde onirique, mais plutôt dans une rêverie qui nous engouffrerait dans la noirceur de l’âme.
Un certain degré de fatalisme imprègne le récit ; les personnages, condamnés à être jugés par nous, les lecteurs, auxquels ils s’adressent parfois directement. Il ne s’agit pas d’un fatalisme anglo-saxon, shakespearien, mais bien de cette langueur mexicaine, qui, poussée à son paroxysme, comporte tous les éléments de la tragédie, de l’ironie du sort : une danseuse obsédée par les applaudissements au point de devenir exhibitionniste, un prêtre pécheur se vengeant d’une morale qui lui a ôté son innocence, un architecte assoiffé de culpabilité, un écrivain public mesquin par dépit, sont les individus qui jalonnent ce livre. Autant de trajets qui mettent en évidence les dangers des amours frustrées, trahies, de la déshumanisation des êtres par la corruption d’un système où tout a un prix.
L’auteur développe avec finesse les dérèglements de l’âme survenant après la déception, la psychologie de ces personnages y est subrepticement étalée, comme autant de justifications de leur attitude.
Serna ne juge pas ses créatures, il les donne en pâture à bien pires carnassiers. Le lecteur se délecte de l’acuité avec laquelle il s’emploie à présenter ces spécimens, et ce n’est qu’après avoir asséné un verdict assassin aux protagonistes des nouvelles que le lecteur-juge s’aperçoit qu’il s’est condamné lui-même. Serna est effectivement redoutable, en cela qu’il nous montre un miroir et que nous ne nous y voyons que lorsque nous cessons de le regarder.
Avec habilité, bien que quelques fois les fins abruptes semblent dictées par la paresse, l’écrivain mexicain dénonce la perversion des rapports humains par une morale, la société de consommation, un système de pensée mesquin qui pousse les gens à ne voir la vie qu’au travers d’ornières, de peur qu’ils ne se rendent compte de la supercherie, tout comme Arturo, le frère du narrateur de la nuit étrangère :
« Notre esclavage était fondé sur une pieuse idée. Papa croyait que l’idée de malheur naissait du contraste avec le bonheur d’autrui et pour éviter à mon frère Arturo, aveugle de naissance, les affres de la comparaison, il décida de créer autour de lui une pénombre artificielle, une douce carapace de mensonges. »
Autre dénonciation de la société de consommation : le récit d’une américaine émue jusqu’aux larmes devant sa télé par un reportage montrant un enfant mexicain, présenté comme orphelin depuis de terribles tremblements de terre par les médias. Se sentant soudain pusillanime, désenchantée par son consumérisme, elle décide de se rendre à Mexico pour adopter l’enfant, qu’elle surnomme Roger. Le conte de fées s’arrête là. Après diverses recherches infructueuses, l’Américaine commence à développer une xénophobie typique des Gringos, et au lieu d’adopter un des nombreux orphelins que fabrique la ville, elle pousse son caprice à l’extrême : Elle n’adoptera que l’enfant vu à la télé, selon l’expression consacrée. La frustration engendrée par l’impossibilité de consommer l’objet de ses désirs ramène notre héroïne à la raison, ou plutôt à sa folie propre, mêlée de mépris et d’orgueil.
Le talent de Serna consiste à nous raconter, à raconter la société occidentale vue d’en bas, de ces pays et de ces personnes qui caricaturent un mode de vie sans saisir son absurdité.
Le style incisif, les expressions imagés nous font avaler la pilule et on en redemande, comme si le fait de lire Amours d’occasion nous guérissait de nos petitesses en les exposant de la sorte.
Sacha Guitry disait : « après un morceau de Mozart, le silence qui suit est encore de Mozart. »
Nous pouvons dire également, toutes proportions gardées avec le dramaturge et le compositeur : « après la lecture d’Enrique Serna, les pensées qui suivent sont encore d’Enrique Serna. » Jean-Louis Benavent |

